
Monde du Travail
D’où viennent les cadeaux
Visite de l’immense centre logistique de Digitec Galaxus, où l’activité bat son plein à Noël.
Navigation
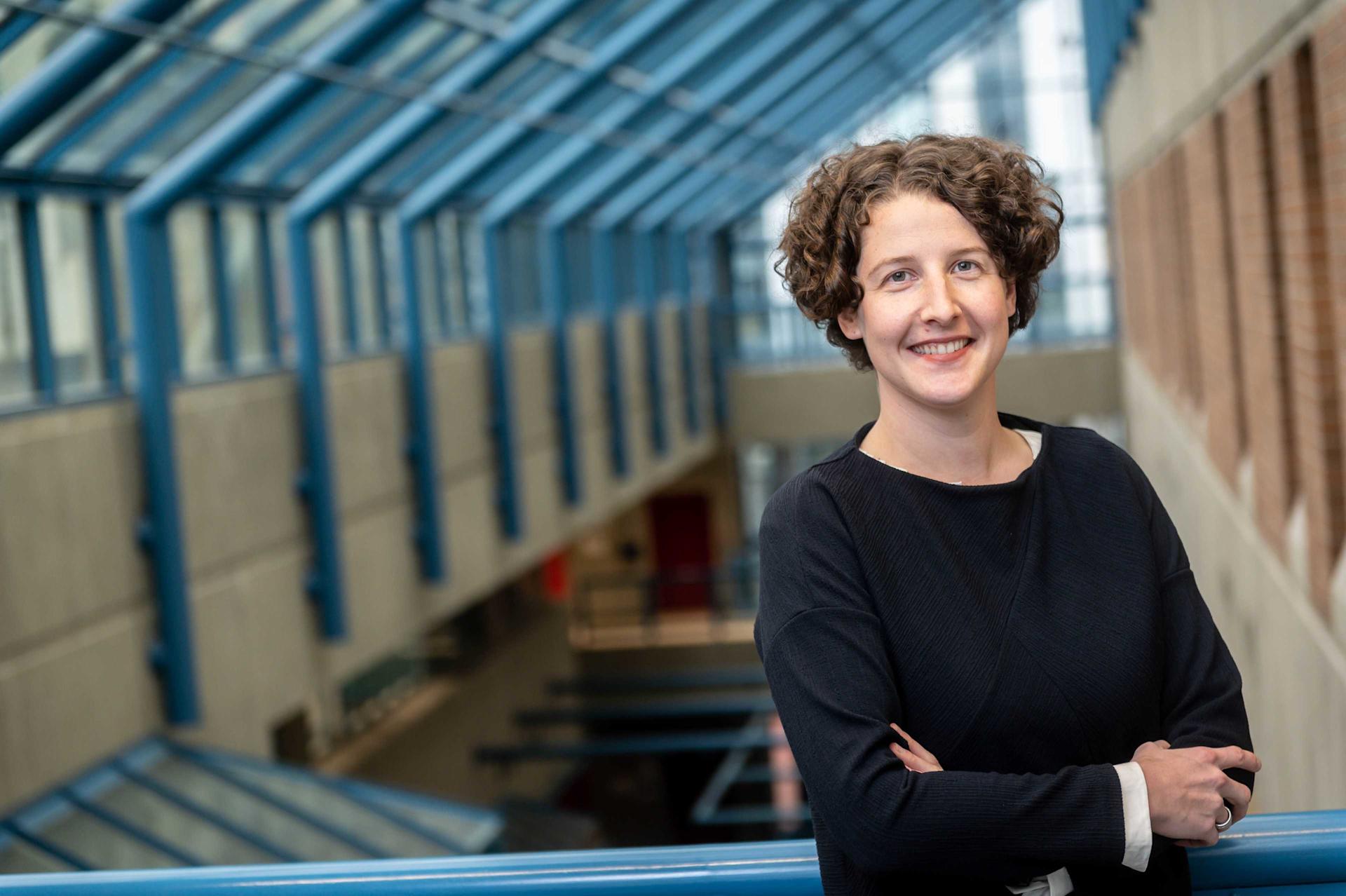
Monde du Travail
En évaluant les gens rapidement, nous avons tendance à les «ranger dans des cases», mais attention aux préjugés injustes! Explorez le sujet du point de vue psychologique et découvrez comment Migros s’engage pour l’égalité des chances.
La nouvelle voisine italienne? - Probablement joyeuse et certainement bruyante! L’homme en costume d’affaires? - Riche et déterminé!
Les clichés sont des catégories grossières dans lesquelles nous classons les gens en fonction de caractéristiques extérieures telles que le sexe, l'âge, la couleur de peau ou l’apparence. «Dans ce contexte, nous considérons une personne comme membre d’un certain groupe et non comme une personne à part entière», explique Christa Nater de l’Institut de psychologie de l’Université de Berne.
Ces généralisations sont façonnées et transmises par la société, les médias et notre environnement personnel.
Parce que le compartimentage aide le cerveau à simplifier notre monde extrêmement complexe et à appréhender plus rapidement les situations sociales. Par exemple, dans le train, lorsque nous demandons si nous pouvons confier nos bagages à un parfait inconnu assis à côté de nous.
«Nous compartimentons pour évaluer ce qui nous attend lors d’une nouvelle rencontre», explique la psychosociologue Nater. Moins nous en savons sur notre interlocuteur, plus le compartimentage est influent.
Les enfants apprennent très tôt à classer les gens dans différentes catégories. Ce procédé est particulièrement marqué en ce qui concerne les rôles dévolus aux genres. Sur la base des observations quotidiennes, de l’éducation et des influences culturelles, les enfants se forgent dès l’âge préscolaire des idées (stéréotypes) sur la façon d’être une femme ou un homme.
Un exemple: comme les femmes portent beaucoup plus souvent les cheveux longs, les enfants associent la longueur des cheveux au sexe féminin. Un homme aux cheveux longs peut susciter l’irritation.
En grandissant, les enfants constatent que les hommes occupent plus souvent des postes de direction, et associent donc des qualités telles que la persévérance aux hommes plutôt qu’aux femmes.
Non! Les préjugés s’accompagnent toujours d'une évaluation, généralement négative, dit Nater. Ce n’est pas encore le cas des «cases» ou des clichés.
Exemple: dans le tram, il y a une place libre à côté d’une femme âgée. Le cliché: «Cette femme entend mal, est lente et a besoin de communiquer». Le préjugé: «Elle veut sûrement m’entraîner dans une conversation énervante».
Tout à fait, estime Christa Nater. Elle cite comme exemple le phénomène selon lequel les femmes sont plus souvent associées à des compétences sociales que les hommes: elles sont considérées comme plus attentionnées et compatissantes. «En fait, beaucoup de femmes se décrivent de la même manière», dit Nater.
Ce cliché est renforcé par le fait que ce sont encore majoritairement les femmes qui, par exemple, gardent les enfants ou soignent leurs proches. Les hommes, en revanche, sont considérés comme assertifs, courageux, ambitieux, parce que ces capacités sont requises dans les postes de direction, où les hommes continuent à être majoritaires – un cercle qui s’autoalimente.
Ainsi, en Suisse, on constate encore aujourd'hui que les filles choisissent moins souvent des professions techniques et scientifiques, tandis que les garçons s’orientent moins souvent vers les métiers des soins.
Lorsque les images dans notre tête nous amènent à désavantager automatiquement d’autres personnes, par exemple dans le monde du travail: «Des études expérimentales ont montré qu’un ‹Martin› est plus souvent invité à des entretiens d’embauche pour un poste de direction qu’une ‹Martina› ayant les mêmes qualifications», explique Nater.
De plus, les personnes dont le nom a une consonance étrangère ont plus de mal à se voir attribuer un logement. «Il est important de remettre en question les stéréotypes pour lutter contre l’inégalité des chances».
Dans une société qui aspire à l’équité et à l’égalité des chances, les gens ne doivent pas être systématiquement désavantagés en raison de leur sexe, de leur couleur de peau, de leur religion ou de leur origine.
En prenant conscience de notre jugement. Nous pouvons nous entraîner à nous arrêter un instant chaque fois que nous faisons une nouvelle rencontre et à remettre en question notre jugement spontané: «Ai-je vraiment assez d’informations sur cette personne pour la juger de manière appropriée et impartiale?»
C’est surtout dans les situations de stress ou de pression du temps que nous devrions ralentir la prise de décision, car on a alors vite fait de juger les gens à la hâte, comme le souligne Christa Nater.
En acceptant de vivre de nouvelles expériences et en cherchant le contact avec des personnes issues d’autres groupes sociaux, on tend vers une plus grande ouverture d’esprit lorsqu’il s’agit de juger nos semblables.
Que ce soit au bureau, dans un magasin ou dans un laboratoire, notre monde du travail est varié. Tout comme les personnes qui l’occupent. Découvre leurs histoires.